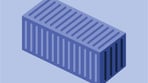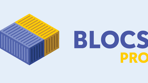Responsabilité sociale et environnementale des multinationales : l’UE sur le reculoir
Le devoir de vigilance en péril... □ Trump précise ses menaces □ La modernisation de l'ALE UE-Mexique □ La chute du champagne


BLOCS#46 □ Bonjour, nous sommes le mercredi 22 janvier et voici le quarante-sixième épisode de votre condensé d’actualité utile sur le commerce international. Suivez-nous sur LinkedIn.
Pour assurer la pérennité et le développement de BLOCS, vous pouvez également nous soutenir à partir de 1 euro, ponctuellement ou mensuellement sur la plateforme de financement participatif Tipeee.
Super-bloc
En mai 2024, l’Union européenne se dotait d’une législation prometteuse, visant à faire progresser la mondialisation vers davantage de durabilité, tant sur le plan environnemental que social : la directive sur le devoir de vigilance des entreprises. Alors que Bruxelles s’apprête à raboter les normes, notamment environnementales, pesant sur les entreprises, ce texte est cependant mis en péril avant même d’être entré en vigueur. Décryptage.

TEXTE EMBLÉMATIQUE □ Fin mai 2024, l’UE adoptait sa directive sur le devoir de vigilance. Un texte destiné à contraindre les grandes entreprises à combattre les atteintes aux droits humains (esclavage, travail des enfants...) et à l’environnement (érosion de la biodiversité, pollution...) sur l’ensemble de leurs chaînes de valeur internationales.
Aujourd’hui, cette loi emblématique du fameux Green Deal est remise en cause avant même son entrée en vigueur, censée débuter en 2027.
À Bruxelles, les législations vertes n’ont en effet plus le vent en poupe, et la priorité de la nouvelle Commission européenne est désormais d’alléger drastiquement les normes pesant sur les entreprises, au nom de la compétitivité.
Le 26 février prochain, le Vice-président exécutif de la Commission européenne chargé de la souveraineté et de la stratégie industrielle, Stéphane Séjourné, présentera ainsi une législation unique, dite «omnibus», visant à raboter plusieurs textes européens.
On sait déjà que la directive sur le devoir de vigilance, qui est dans le collimateur des organisations patronales, comme le Medef en France, la Confindustria en Italie et le puissant BDI en Allemagne, fera partie de la liste.
De fait, la directive doit imposer un ensemble de procédures assez lourdes aux plus de 5.500 entreprises qu’elle ciblerait à terme - soit celles comportant plus de 1 000 salariés et avec un chiffre d'affaires supérieur à 450 millions d’euros par an, dont certaines sociétés étrangères actives dans l’UE.
CONCRÈTEMENT □ Exemples : l’obligation pour ces groupes d’identifier les abus et les éventuels risques via une cartographie de leurs sous-traitants - y compris de plus petites tailles - à travers monde ; ou encore celles d’imposer à ces partenaires des codes de conduites, de négocier avec eux des garanties contractuelles, de les aider financièrement à respecter les règles, ou encore de prévoir des audits sur leurs sites de production …
...