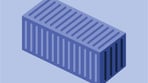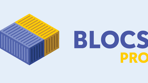La drôle de guerre commerciale de Trump
Feu d'artifice américain, mais aussi... □ La boussole européenne de compétitivité □ Rapprochement commercial post-Brexit □ Des constructeurs saisissent la justice européenne


BLOCS#47 □ Bonjour, nous sommes le mercredi 29 janvier et voici le quarante-septième épisode de votre condensé d’actualité utile sur le commerce international. Suivez-nous sur LinkedIn.
Pour assurer la pérennité et le développement de BLOCS, vous pouvez également nous soutenir à partir de 1 euro, ponctuellement ou mensuellement sur la plateforme de financement participatif Tipeee.
Super-bloc
Des propos menaçants et contradictoires, un épisode colombien rocambolesque et un revers boursier malvenu… Les premiers jours de la deuxième présidence Trump n’ont pas été de tout repos. Si la guerre commerciale promise par l’épouvantail de la Maison Blanche n’a pas - encore ? - eu lieu, le chaos est déjà palpable. À J+9, BLOCS tire un premier bilan.

RETRAITS EN SÉRIE □ La crainte de voir Donald Trump se lancer à bras raccourcis dans la guerre commerciale, en imposant des mesures agressives dès le jour de son investiture comme il l’avait lui-même annoncé, ne s’est pas réalisée.
Si le nouveau président américain a bien signé une cascade de décrets présidentiels (‘executive orders’) dès son investiture, lundi 20 janvier, ceux-ci concernent la migration, les personnes transgenres, ou encore le climat, mais pas le commerce.
Ce dernier sera certes indirectement affecté par le retrait américain de l’accord de Paris de 2015 ou de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) décidés à cette occasion. Ces deux départs préliminaires marquent en outre une nouvelle fois le mépris de M. Trump pour le multilatéralisme.
À noter aussi : le retrait de l’accord OCDE conclu en 2021, concernant la fiscalité internationale des entreprises. Si celui-ci ne devrait pas produire de grands effets, l’accord ayant déjà été intégré à beaucoup de législations, dont celles des pays de l’UE, celui-ci est doublé d’une menace de mesures de rétorsions qui pourraient bouleverser le cadre fiscal international.
Sur le front commercial, outre le lancement d’enquêtes, notamment sur les pratiques commerciale de la Chine, une seule décision ferme a néanmoins été prise depuis l’investiture de M. Trump : le déblocage de livraisons d’armes à destination d’Israël, dont notamment des bombes de 2.000 livres (907 kg).
CONTRADICTION N’EST PAS RAISON □ Les premiers jours de Trump II auront ainsi surtout été rythmés par des déclarations en tout genre, souvent menaçantes, et parfois contradictoires entre elles.
Jeudi, le président américain a ainsi déclaré qu’il préférerait ne pas avoir à imposer de droits de douane à la Chine. Le même Trump avait pourtant promis quatre jours plus tôt qu’il imposerait des tarifs de 10% aux produits chinois à compter du 1er février. Pendant la campagne, il menaçait même Pékin de droits de douane de 60%.
...