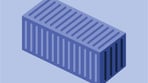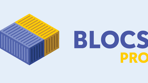Trump, Mercosur, fret maritime… Les sujets commerce qui rythmeront 2025
Les quatre dossiers brûlants de l'année qui commence... □ Le nouveau ministre du Commerce extérieur □ L'économie russe sous pression □ Joe Biden bloque le projet d'acquisition de US Steel par Nippon Steel


BLOCS#44 □ Bonjour, nous sommes le mercredi 8 janvier et voici le quarante-quatrième épisode de votre condensé d’actualité utile sur le commerce international. Suivez-nous sur LinkedIn.
Pour assurer la pérennité et le développement de BLOCS, vous pouvez également nous soutenir à partir de 1 euro, ponctuellement ou mensuellement sur la plateforme de financement participatif Tipeee.
Super-bloc
Les tensions géopolitiques devraient toujours plus détraquer la machine commerciale globale en 2025. Illustration avec un état des lieux des quatre sujets qui s’annoncent comme les plus chauds de l’année qui commence.

CHALEUR TRUMPIENNE □ Douze jours avant l’investiture de Donald Trump, la planète commerce a de quoi trembler.
En campagne, l’homme qui s’est auto-surnommé le « Tariff Man », a promis de faire ingurgiter au monde un redoutable cocktail de droits de douane, composé d’une surtaxe de 10, voire 20%, sur la quasi-totalité des biens importés et une barrière de 60% pour les marchandises chinoises.
Des menaces qui ont continué de plus belle après son élection, ciblant en particulier le Mexique et le Canada, qui pourraient écoper de tarifs douaniers de 25% (BLOCS#40).
Si l’incertitude règne quant à la propension de l’épouvantail américain à tenir parole, son élection a déjà un impact sur les prévisions commerciales.
Dans son scénario le plus optimiste, Allianz Trade estime ainsi qu’une « guerre commerciale contenue » pourrait « ramener la croissance nominale du commerce mondial en dessous de 5 % en 2026 (-0,6 point de pourcentage), avec 67 milliards de dollars d'exportations menacées en Europe et en Chine en 2025-2026 (la moitié du total mondial) ».
Une guerre commerciale totale aurait quant à elle un effet dévastateur global, en particulier sur l’économie américaine qui souffrirait de taux d’inflation inédits.
La France ne serait pas épargnée : ses gains à l'exportation sur la période 2025-2026 « tomberaient à 50,6 milliards de dollars, soit 13,4 milliards de dollars de moins que notre estimation précédente », expliquent les économistes d’Allianz.
Reste à savoir comment les Européens réagiront aux menaces commerciales trumpiennes, qui s’accompagnent de marchandage sur la garantie de sécurité américaine et d’incertitudes entretenues sur la question ukrainienne (BLOCS#38).
Dans une récente note publiée par le Centre Jacques Delors, les chercheurs Elvire Fabry et Arthur Leichthammer affirment que « l’UE est mieux préparée à relever ces défis que lors du premier mandat de Trump ».
« Grâce à un mélange de dissuasion et d’incitations ciblées telles qu’une augmentation des achats d’énergie et de défense, l’UE peut renforcer sa position de négociation, dont la force reposera fondamentalement sur son unité », analysent encore les deux chercheurs.
La présidente du Conseil italienne, Giorgia Meloni, a néanmoins semé le doute sur la capacité des Européens à rester solidaires, en se rendant ce week-end en solo à à Mar-a-Lago, pour rencontrer le président élu, comme le relatent nos amis de la Matinale européenne dans leur édition de lundi.
PARIS PAS LATINO □ La conclusion des négociations autour d’un accord commercial entre l’UE et le Mercosur (Brésil, Uruguay, Argentine, Paraguay), entérinée par Ursula von der Leyen le 6 décembre 2024, ne marque certainement pas la fin de cette saga qui dure depuis plus de deux décennies.
La France, qui s’est opposée frontalement à ce traité de libre-échange en gestation (BLOCS#39), est en effet loin d’avoir dit son dernier mot.
« La messe n'est pas dite (...) On continuera de défendre avec force la cohérence de nos engagements et donc (une) politique commerciale cohérente », a ainsi martelé Emmanuel Macron devant les ambassadeurs français réunis à l'Élysée, lundi.
L’accord paraphé le mois dernier doit en effet encore parcourir un long chemin démocratique avant d’être ratifié et d’entrer en vigueur.
La France, dont l’opposition ne devrait a priori pas suffire à faire tomber le texte, tentera de se trouver des alliés à la table du Conseil. Rome et Varsovie, qui ont exprimé leurs réserves avant le 6 décembre, semblent plus ouverts au compromis que Paris.
Les agriculteurs européens pourraient aussi jouer un grand rôle dans le processus politique. Mi-décembre, quelques 5 000 agriculteurs ont ainsi manifesté devant le ministère de l’Agriculture espagnol, reprochant à l’accord de créer une concurrence déloyale (BLOCS#43).
La colère agricole, qui s’était vigoureusement exprimée au début de l’année dernière, couve aussi dans d’autres pays de l’UE dont la France.
La solution pourrait venir de la mise en place d’un fonds européen de compensation pour les agriculteurs.
L’issue de ce processus politique en dira beaucoup sur la capacité ou non de l’UE à s’engager dans de nouveaux accords commerciaux ambitieux.
XI À LA RELANCE □ « Peu importe l'évolution de l'environnement extérieur, incertain et changeant, les actions de la Chine en matière d'ouverture ne faibliront pas », a affirmé ce vendredi lors d'un point presse Zhao Chenxin, vice-président de la Commission nationale du développement et de la réforme.
Des déclarations qui peuvent paraître surprenantes au vu de la détérioration globale de l’attractivité de la Chine, qui a notamment conduit à une baisse des investissements directs étrangers dans le pays en 2023, à un plus bas depuis 1993 (BLOCS#18).
Sur le plan commercial, Pékin pense sans doute avoir une carte à jouer, en s’imposant comme un interlocuteur raisonnable, en comparaison avec l’outrancier Donald Trump.
L’ouverture affichée par M. Chenxin devra néanmoins s’accompagner de résultats tangibles pour être crédible. Trouver une solution négociée au conflit Pékin-Bruxelles entamé cet été autour des voitures électriques chinoises serait un bon début (BLOCS#43).
La capacité ou non de la Chine à éviter une guerre commerciale totale avec les Etats-Unis reste aussi à prouver.
Sur le front américain, Xi Jinping adopte pour l’heure une attitude dure et déterminée. Le président chinois a ainsi refusé l’invitation de M. Trump à participer à sa cérémonie d’investiture, et prépare sa riposte aux attaques promises par le président élu.
« La confiance de Pékin est à l’image de celle de l’équipe Trump, analyse le chercheur américain Evan Medeiros dans une tribune publiée par le Financial Times. Les deux camps pensent avoir l’avantage, pouvoir imposer des coûts plus élevés et endurer davantage de souffrances. Le terrain est donc propice à une dynamique complexe et déstabilisatrice qui, au mieux, aboutira à un cessez-le-feu. Et cela ne concerne que les questions économiques, pas Taïwan, la mer de Chine méridionale, la concurrence technologique ou la modernisation des armes nucléaires. La guerre froide commence à paraître désuète en comparaison ».
LES PARADOXES DU FRET MARITIME □ Les tensions géopolitiques devraient continuer d’affecter le fret maritime en 2025. En Syrie, la chute du régime Assad pourrait en effet augmenter encore la déstabilisation de la région, et l’arrivée au pouvoir de M. Trump aux Etats-Unis créer de nouveaux soubresauts avec l’Iran.
De quoi laisser présager une perpétuation, voire une aggravation des attaques de navires commerciaux en mer Rouge, qui obligent depuis plus d’un an une bonne partie des porte-conteneurs, privés d’accès au canal de Suez, à contourner le continent africain via le Cap de Bonne Espérance.
Une situation qui a conduit à augmenter les temps de trajet, tendre l’offre de fret maritime et a ainsi, paradoxalement, multiplié les bénéfices des grandes compagnies maritimes, qui n’ont pas eu à subir les conséquences des surcapacités qui s’annonçaient.
Les tensions géopolitiques, notamment autour du canal de Panama, dans le viseur de M. Trump qui affirme qu’il est contrôlé par la Chine, mais aussi les menaces de grève des dockers, notamment aux Etats-Unis, ainsi que la réduction des flux que devrait provoquer la guerre commerciale qui s’annonce, pourraient faire de 2025 une année encore plus tendue que 2024 pour le fret maritime.
...